Lukas Madl
Comment intégrer les connaissances de sols urbains dans la pratique de renaturation ?
Vers un outil d’aide pour les décideurs et praticiens
Au cours des dernières décennies, les populations urbaines ont connu une forte croissance, et cette tendance devrait se poursuivre, avec 68 % de la population mondiale vivant en ville d'ici 2050 (Eurostat, 2022; United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2019). En parallèle, les villes s'étendent souvent à leur périphérie, phénomène désigné sous le nom d'étalement urbain. La création de logements ainsi que celle de nouvelles activités économiques, commerciales, et industrielles s'accompagne très souvent de la consommation de sols « non artificialisés », et donc la transformation d'espaces naturels, forestiers ou agricoles en espaces urbanisés ou « artificialisés »(Decoville and Feltgen, 2023). Cependant, cette urbanisation massive engendre des problèmes environnementaux graves, tels que la dégradation des sols, l’érosion de biodiversité et l'aggravation du changement climatique (IPBES, 2019, 2018; Zhan et al., 2023).
Face à ces défis, il devient impératif de transformer les stratégies de développement urbain en intégrant des principes de densification, d'infrastructure verte et de synergie entre ces éléments, sous-tendant le modèle de la « ville compacte » (Artmann et al., 2019). Les espaces verts urbains, en particulier, jouent un rôle crucial dans ces stratégies, car ils fournissent des services écologiques pour atténuer les impacts environnementaux et améliorer la qualité de vie des citadins (Busca and Revelli, 2022).
Cependant, l’amélioration des écosystèmes urbains, notamment dans les zones fortement dégradées, reste un défi majeur, surtout à cause des conditions environnementales souvent très hostiles. Les sols ont longtemps été négligés dans la planification urbaine et les projets de restauration écologique (Farrell et al., 2020; Landauer, 2019). Pourtant, leur amélioration joue un rôle central, car ils sont au cœur de tout écosystème fonctionnel et fournissent multiples services écosystémiques. Par conséquence, la reconnaissance du rôle multifonctionnel des sols et de leur caractère fini en tant que ressource, sont désormais au centre des débats environnementaux et des politiques publiques européennes (Commission européenne, 2023, 2021).
Dans la démarche de répondre à la dégradation des écosystèmes, la renaturation est un terme dont son utilisation augmente de manière inflationnaire. Sa définition restant floue, elle semble incarner une large gamme d’opérations d’aménagement urbaine visant à la création des espaces verts en ville. On constate un changement de paradigme dans la mise en œuvre de ces projets, qui accorde davantage d'importance aux sols et à leurs fonctions écologiques dans la conception des projets. Cette évolution s'accompagne d'une augmentation du nombre d'études axées sur l'intégration des connaissances pédologiques dans les projets de renaturation (Blanchart et al., 2018; Deboeuf de Los Rios et al., 2022 ; Monfort et al., 2019; Schwartz et al., 2024, 2022; Taugourdeau et al., 2020). Néanmoins, les travaux scientifiques qui traitent au niveau opérationnel de l'adaptation des méthodes et techniques de renaturation aux conditions locales sont rares.
Cette thèse cherche à contribuer au rassemblement du savoir concernant ce sujet à travers plusieurs étapes. Dans un premier temps, le concept de renaturation sera examiné à travers ses définitions et les mesures qui y sont associées et recommandées. Ensuite, plusieurs études de cas françaises permettront d'analyser les facteurs qui influencent le choix des mesures de renaturation mises en œuvre ; la manière dont les acteurs naviguent entre les obstacles qui se présentent ; et la mesure dans laquelle les connaissances écologiques sur les sols alimentent la planification et la mise en œuvre de la renaturation. Les résultats serviront à élaborer des recommandations à destination des maitrises d’ouvrage et les maitrises d’œuvre afin d'adapter au mieux les futurs projets de renaturation aux conditions locales ; de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement ; et de maximiser les effets positifs sur la faune et la flore. »
–
Cadre du doctorat
◖ Direction de thèse
Youssef Diab
(HDR) Lab'Urba
Mathieu Delorme
(co-encadrant) Laboratoire OCS
◖ Institutions de rattachement
01.2024-en cours
Thèse sous contrat CIFRE chez AREP
◖ Environnement de recherche
Laboratoire OCS
Lab'Urba
–
–
Sur la recherche
◖ Mots-clés
Renaturation, refonctionnalisation des sols, SUITMA, connaissance écologique des sols, usage de sols
◖ Affiches scientifique
- Journées de la recherche
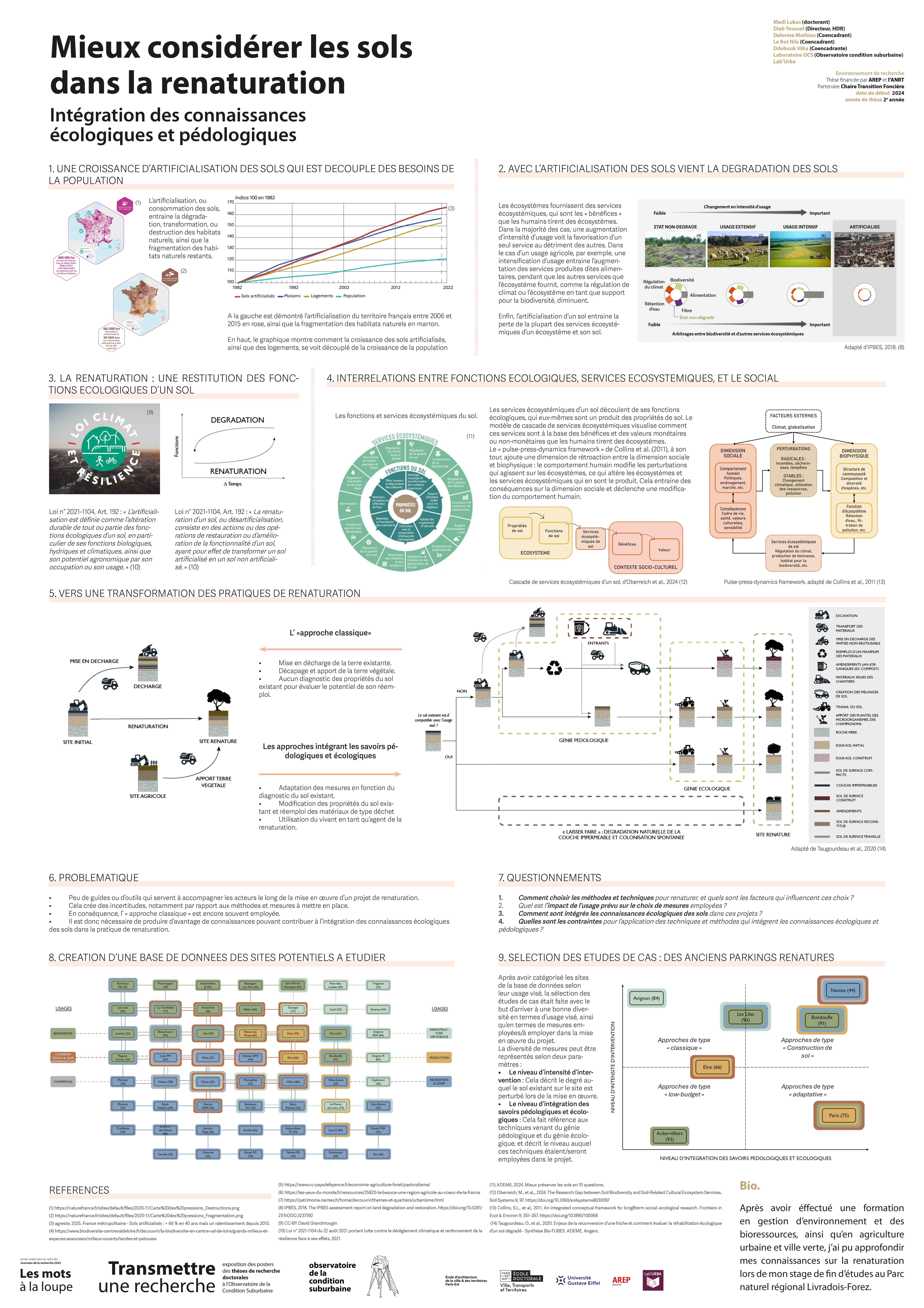
Voir l'affiche en grand
- Journées d'étude des sols

Voir l'affiche en grand
◖ Bibliographie
Voir la bibliographie →
–
Illustration →
Photographie de Lukas Madl
